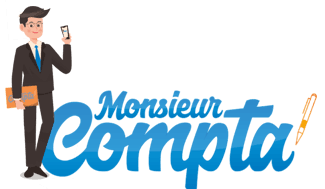Le financement constitue un enjeu central pour les startups françaises, tant pour leur création que pour leur développement. Différents mécanismes existent, chacun répondant à des besoins spécifiques et soumis à un cadre juridique particulier.
Comprendre ces dispositifs, leurs avantages, leurs contraintes et leurs risques est essentiel pour tout entrepreneur souhaitant lever des fonds.
(« Compte tenu du développement important du financement participatif dans les différents États de l’Union européenne, le règlement UE 2020/1503 du 7 octobre 2020 (règlement « Crowdfunding »), en vigueur depuis le 10 novembre 2021 et directement applicable dans chaque État membre, a fixé un cadre européen harmonisé en créant un statut commun pour les plateformes de financement participatif : le statut de prestataire de services de financement participatif (PSFP). ») [1]
1. Les principales formes de financement accessibles aux startups
A. Fonds propres : ouverture du capital
- Description : Augmentation de capital par l’entrée de nouveaux actionnaires (business angels, fonds d’investissement, capital-risque, corporate venture).
- Cadre juridique : Relève du droit des sociétés (Code de commerce), nécessitant l’émission de titres (actions, obligations, etc.) et la modification des statuts le cas échéant.
- Points de vigilance :
- La dilution de la participation des fondateurs est un enjeu majeur, d’où l’importance des clauses anti-dilution dans les pactes d’actionnaires (« cette clause permettra à l’investisseur de maintenir en pourcentage pendant la durée de son investissement le niveau de participation qu’il a atteint lors de son entrée au capital. […] la clause prévoit soit de réserver une augmentation de capital à l’investisseur, soit de lui céder un nombre de droits sociaux suffisant au maintien de sa participation. ») [2].
- L’entrée de nouveaux investisseurs peut influencer la gouvernance et la stratégie de l’entreprise (« Par ailleurs, les sociétés en forte croissance peuvent aussi ouvrir leur capital à des partenaires. En effet, la perspective d’une rentabilité élevée du capital peut intéresser de nombreux investisseurs potentiels. Cependant, il s’agit là d’un choix irréversible, l’ouverture du capital conditionnant les décisions stratégiques futures. ») [3].
- Avantages : Apport de fonds propres, crédibilité accrue, accompagnement stratégique.
- Risques : Perte de contrôle, dilution, exigences accrues de reporting et de performance.
B. Financement participatif (crowdfunding)
- Description : Mobilisation de fonds via des plateformes en ligne, soit sous forme de prêts (avec ou sans intérêt), de titres (actions, obligations), ou de dons.
- Cadre juridique :
- Depuis le 10 novembre 2021, le règlement UE 2020/1503 harmonise le régime européen du crowdfunding, introduisant le statut de PSFP (prestataire de services de financement participatif), qui remplace progressivement les anciens statuts de CIP (conseiller en investissements participatifs) et adapte les rôles des autres intermédiaires (« Le règlement UE 2020/1503, en vigueur depuis le 10 novembre 2021, a établi des exigences uniformes au niveau européen pour les offres de financement participatif d’un montant total inférieur à 5 M€ sur 12 mois […] et a créé un nouveau statut européen, celui de prestataire de services de financement participatif (PSFP). ») [4], [5], [1], [6].
- Les offres doivent être inférieures à 5 M€ sur 12 mois, hors dons et prêts sans intérêts, et porter sur des titres financiers ou instruments admis à ces fins (« les offres au public relevant du financement participatif autorisées sont désormais définies comme celles portant sur des titres financiers et des instruments admis à des fins de financement participatif (parts sociales et actions transférables) proposées par un PSFP au sens du règlement UE 2020/1503, pour autant qu’elles n’excèdent pas un montant de 5 M€ (C. mon. fin. art. L 411-2, 2 o modifié ; Règl. UE 2020/1503 art. 1). ») [4], [5].
- Les minibons sont supprimés depuis le 10 novembre 2022, seuls ceux acquis avant cette date restent éligibles à certains dispositifs comme le PEA PME-ETI
Points de vigilance :
- Vérifier l’agrément de la plateforme.
- Limite de montant (5 M€ sur 12 mois).
- Disparition des minibons pour les nouveaux financements.
- Avantages : Accès à un large public, rapidité de collecte, valorisation marketing.
- Risques : Communication publique des projets, dispersion de l’actionnariat, risques de non-souscription ou de non-remboursement pour les prêts.
C. Prêts bancaires classiques et spécifiques
- Description : Prêts à moyen ou long terme auprès des établissements bancaires.
- Cadre juridique : Contrat de prêt encadré par le Code monétaire et financier.
- Points de vigilance : Nécessité de présenter un business plan solide et crédible
Les banques prêteront à une jeune société normalement rentable moyennant un solide compte d’exploitation prévisionnel établi ou validé par l’expert-comptable assistant le dirigeant de l’entreprise. »)
- Exigence fréquente de garanties ou de cautions, qui peuvent être partiellement limitées grâce à des dispositifs publics de garantie
- Avantages : Effet de levier financier, non-dilution du capital.
- Risques : Endettement, exigence de garanties, remboursement à honorer même en cas de difficultés.
D. Prêts garantis par l’État (PGE) et avances remboursables
- Description : Prêts mis en place notamment dans le cadre de la crise sanitaire, garantis par l’État pour soutenir la trésorerie des entreprises.
- Cadre juridique : Réglementation spécifique, limitée dans le temps, encadrée par des décrets et arrêtés (ex : Arrêté du 19-6-2020, Décret 2020-712).
- Conditions d’accès :
- Montant plafonné à 25 % du chiffre d’affaires 2019 ou, pour les entreprises innovantes/créées après 2019, à deux fois la masse salariale de 2019 ou la masse salariale estimée sur deux ans
- Différé d’amortissement minimal de 12 mois, puis possibilité d’amortir sur 1 à 5 ans supplémentaires.
- Avantages : Accès facilité au crédit, absence de garantie ou de sûreté supplémentaire pour la plupart des entreprises.
- Risques : Endettement, nécessité de respecter les critères d’éligibilité, échéances à venir.
E. Crédit-bail (leasing) et lease-back
- Description : Financement d’équipements ou d’immobilier par location avec option d’achat.
- Cadre juridique : Contrat de crédit-bail régi par le Code monétaire et financier.
- Points de vigilance :
- Engagements à mentionner dans l’annexe des comptes sociaux.
- Attention à la durée du contrat et à la valeur résiduelle.
- Avantages : Préservation de la trésorerie, financement de la totalité de l’investissement, amélioration du bilan.
- Risques : Coût global, engagement sur la durée, dépendance vis-à-vis du bailleur.
F. Subventions publiques et concours
- Description : Aides financières de l’État, des collectivités locales ou d’organismes publics (ex : Bpifrance, concours d’innovation).
- Cadre juridique : Soumises à des appels à projets et à des conditions d’éligibilité strictes.
- Points de vigilance :
- Veiller à bien rentrer dans les critères d’attribution, difficulté d’accès à l’information
- Avantages : Non-remboursables ou à taux préférentiel, effet levier.
- Risques : Processus long, incertitude d’obtention, contrôles a posteriori.
2. Cadre juridique général et évolutions récentes
- Harmonisation européenne : Depuis novembre 2021, le financement participatif est encadré par le règlement (UE) 2020/1503, qui impose un statut unique pour les plateformes et une période transitoire jusqu’au 10 novembre 2023 pour l’adaptation des acteurs français
- Suppression des minibons : Les minibons, précédemment utilisés dans certains dispositifs de crowdfunding, ne sont plus autorisés depuis le 10 novembre 2022
3. Tableau synthétique des principales solutions de financement
|
Solution |
Cadre juridique |
Conditions d’accès |
Avantages |
Risques/Points de vigilance |
|---|---|---|---|---|
|
Fonds propres (capital) |
Code de commerce, pactes |
Assemblée générale, statuts |
Apport fonds, accompagnement |
Dilution, perte de contrôle, clauses anti-dilution nécessaires [2], [11] |
|
Règlement UE 2020/1503, C. mon. fin. |
Montant < 5 M€, plateforme agréée |
Visibilité, rapidité |
Risque de non-souscription, disparité entre plateformes, disparition des minibons [4], [5], [1] |
|
|
Prêt bancaire |
Code monétaire et financier |
Analyse projet, garanties |
Effet de levier, non-dilution |
Exigence de garanties, remboursement [3], [7] |
|
Prêt garanti par l’État |
Arrêtés/décrets spécifiques |
Plafond CA ou masse salariale |
Accès facilité, différé |
Endettement, critères stricts [8], [9], [10] |
|
Crédit-bail/Lease-back |
Code monétaire et financier |
Actifs à financer |
Préserve trésorerie, bilan |
Coût, engagement long terme [3] |
|
Subventions/concours |
Appels à projets, règlements |
Dossier, éligibilité |
Non-remboursable, effet levier |
Procédure longue, incertitude [3] |
4. Points de vigilance et conseils pratiques
- Clauses anti-dilution : Elles permettent à l’investisseur de maintenir sa participation lors d’émissions ultérieures de titres. Il est essentiel d’en négocier les modalités dès l’entrée d’un investisseur
- Pacte d’actionnaires : Document contractuel entre associés, il encadre les relations entre fondateurs et investisseurs, abordant notamment la gouvernance, les sorties et la protection contre la dilution.
- Sélection de la plateforme de crowdfunding : Privilégier les plateformes agréées PSFP et vérifier leur conformité au règlement européen
- Garanties et cautionnements : Les banques exigent souvent des garanties personnelles ou réelles. Certains dispositifs publics permettent de limiter cet engagement
- Conditions d’éligibilité : Les aides et financements publics sont conditionnés à des critères stricts. Il est recommandé de se faire accompagner en financement (expert-comptable, avocat, incubateur) pour optimiser les chances d’obtention et la structuration de ce dernier.
Conclusion
Le financement des startups en France repose sur une diversité de solutions, chacune répondant à des besoins et des stades de développement spécifiques.
La compréhension du cadre juridique, la préparation rigoureuse des dossiers, la négociation des conditions (notamment sur la dilution et la gouvernance) et la vigilance quant à l’évolution des dispositifs réglementaires sont des points clés pour réussir une levée de fonds.
Il est conseillé aux entrepreneurs de s’entourer de conseils spécialisés pour sécuriser leur parcours de financement et anticiper les risques inhérents à chaque source de fonds.